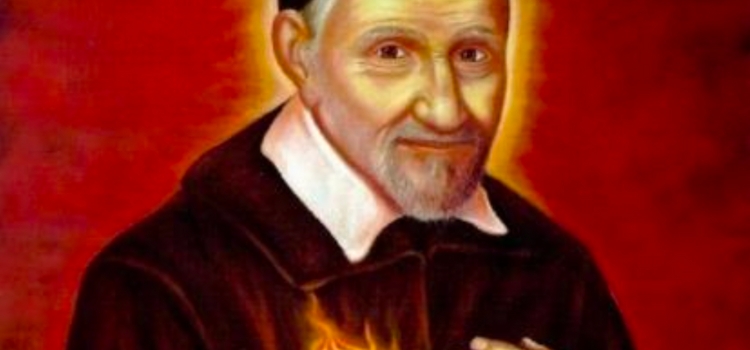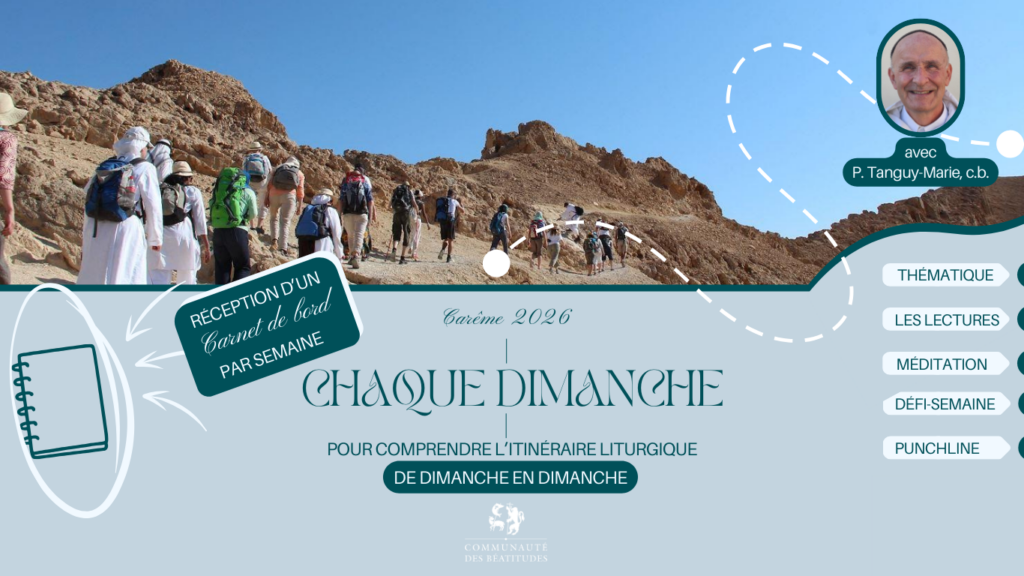Introduction
Au moment où je commence à mettre en forme cet essai, mon téléphone sonne. Il s’agit de Bruno (j’ai changé le prénom par discrétion). Bruno m’appelle de temps en temps, une ou deux fois par an pour échanger quelques nouvelles, pour garder le lien, pour parler de nos amis communs ; Bruno souffre d’un handicap moteur, il fait partie d’une association, fait du théâtre… mais, du point de vue de la société de consommation, donc de production, on peut volontiers le classer parmi les personnes inutiles, les personnes à charge. Pour répondre à Bruno, il faut renoncer un temps à nos projets, prendre du temps, avoir même la sensation de perdre son temps…
Savoir perdre son temps
Évidemment, il est vital de répondre à cet appel téléphonique, ou de rappeler sans trop tarder. Qui d’entre nous, en effet, n’a pas été un jour aidé ou juste soutenu fraternellement ou humainement par une personne qui avait peut-être alors l’impression de perdre son temps ? Le Seigneur lui-même regarde-t-il la rentabilité du don de son Amour pour nous ? Heureusement que non ! C’est pourquoi il nous faut parfois considérer avec grande attention la façon dont nous donnons et la façon dont nous prions. Le temps que nous avons parfois l’impression de perdre à l’oraison peut être le plus important, le plus fécond. Il ne s’agit bien sûr pas de gaspiller notre temps. Le temps est certainement ce que nous avons de plus précieux à dépenser et à offrir. Ne soyons pas « affairés sans rien faire » (2Th 3,11), paresseux pour les tâches importantes et les services qui nous sont confiés. Mais même les meilleures volontés et les plus organisés peuvent éprouver la peur ou la sensation de perdre leur temps. Cela peut venir de la conscience d’avoir des choses plus importantes à faire (à tort ou raison), du fait de n’avoir pas de goût pour la tâche en cours, ou encore du sentiment d’être nuls dans ce domaine. Bref, du sentiment d’impuissance.
J’ai tellement de choses à faire !
« Une demi-heure de méditation est essentielle sauf quand on est très occupé. Alors une heure est nécessaire » (Saint François de Sales). Pourquoi ? On peut donner au moins trois raisons, de la plus utile à la plus essentielle. La raison la plus utile, pleine de bon sens et présente dans les stratégies modernes de gestion du temps, est que ce que saint François de Sales appelle la « méditation », et que nous appelons l’oraison, permet de ne pas se précipiter sans réflexion dans l’action, de ne pas s’épuiser en se dispersant dans toutes les directions ou en se laissant harceler par l’inquiétude. Tout investissement dans une action nécessite au préalable de se poser (cf. Lc 14, 28-30). Une raison fondamentale de garder une priorité absolue à la prière est que le temps passé à chercher Dieu (ou à se laisser trouver par Lui : « Où es-tu donc ? », Gn 3,9) permet de travailler en profondeur nos motivations et la façon dont nous donnons. Comme l’écrit saint Paul : « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait » (Rm 12,2). Celui qui s’adonne à l’oraison entre dans la sagesse du Dieu qui a prescrit le Shabbat (littéralement « cesser », « stopper ») : se tourner résolument vers la contemplation de Dieu et de son Amour, pour ne plus être uniquement dans une attitude de production et risquer de tomber dans l’idolâtrie devant l’œuvre de nos mains.
Mais la raison la plus essentielle, qui a bien sûr des répercussions sur les deux premières, est que Dieu, avant toutes choses, avant que nous réalisions quoi que ce soit, nous veut avec Lui ! Lorsque Jésus choisit ses apôtres, il est écrit dans Mc 3,14 : « Puis, il gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle ». Lorsque Dieu renouvelle son appel à Abraham (Gn 17), il lui dit : « Je suis le Dieu-Puissant ; marche en ma présence et sois parfait. J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance à l’infini. » Enfin, le premier être humain qui a consolé le cœur de Dieu après la chute originelle semble être Hénoch (Gn 5) : « Après avoir engendré Mathusalem, Hénoch marcha encore avec Dieu pendant trois cents ans et engendra des fils et des filles. Hénoch vécut en tout trois cent soixante-cinq ans. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut car Dieu l’avait enlevé ». Sommes-nous désireux de « marcher avec Dieu » ? Une chose est sûre : Dieu désire ardemment « marcher » avec chacun d’entre nous ! Comme le dit Jésus à Marthe à propos de sa sœur (Lc 10, 38-42) « Marie a choisi la meilleure
part, elle ne lui sera pas enlevée. »
Sentiments et fidélité
Qui n’a jamais connu de sentiments de dégoût, d’inutilité ou d’impuissance dans le don de soi ou dans l’oraison ? Hormis des situations particulières, sur lesquelles un discernement doit être évidemment appliqué, il arrive que ces sentiments soient les symptômes d’une visite de Dieu en profondeur. Quoi qu’il en soit, rien ne saurait remettre en question notre fidélité à la prière. Concernant le sentiment d’impuissance dans la prière, on pourra relire avec consolation le passage du Manuscrit B où la petite Thérèse se compare à un petit oiseau chétif incapable de voler vers son Seigneur (Ms B, 4v°-5v°).
Dieu seul est don
La clé de compréhension de nombre de passages de l’Évangile où Dieu nous semble injuste ou excessif (l’expression « serviteur inutile » ou bien la parabole des ouvriers de la dernière heure) ne serait-elle pas son désir de voir tous les hommes, sans exception, rassemblés dans sa Maison ? Nous pourrions relire à ce sujet le livre de Jonas… L’unique critère de jugement divin de nos actes est que tout don de nous-mêmes, certes nécessaire, trouve sa source en Lui, sans aucun mérite de notre part. Puissions-nous simplement souffrir de sa souffrance et nous réjouir de sa joie dans Sa mission de Salut. Pour cela, approchons-nous de son Cœur…
|
Se recevoir puis se donner, tout un art… ! Comment est-ce que je me situe dans ces quatre manières de se rapporter au don de soi, et ce dans les différents domaines de ma vie ? Je peux demander la lumière du Saint-Esprit et la grâce de progresser dans un juste don de moi-même : – Je reçois pour recevoir : j’estime ne pas être en mesure de donner et devoir seulement recevoir, encore et encore ! – Je ne veux que donner : je pense que ma vie n’a de valeur que si je donne, sans prendre le temps du ressourcement. – Je donne pour recevoir : donner peut m’aider à prendre conscience que j’ai besoin de recevoir, mais mon don est-il gratuit et désintéressé ? – Je reçois pour donner : je prends conscience que Dieu m’aime gratuitement, ensuite que je suis canal du don de Dieu. Le sens de ma vie est de contribuer à une œuvre à laquelle je suis appelé, ce qui me remplit de joie et propage la grâce du Royaume autour de moi.
|
La citation
«Monsieur Vincent répétait souvent cette parole devenue un lieu commun sur ses lèvres : donnez-moi un homme d’oraison, et il sera capable de tout ; il pourra dire avec le saint apôtre : Je puis toutes choses en Celui qui me soutient et me conforte. » (Père Arnaud d’Agnel)
Pour aller plus loin…Rien que pour aujourd’hui Je peux méditer ces deux paroles de Jésus et les laisser façonner mon cœur :
Lectures
Film
|
Retrouvez les articles précédents de notre série « Vie d’oraison ».
Textes écrits par des frères et sœurs de la Communauté des Béatitudes et édités aux Éditions des Béatitudes – ©droits réservés